Histoire du canton
de
Coucy-le-Château
par
L'abbé A. Vernier
1876
INDEX :
Bichancourt (Becencurtis, 1089 ; Becenicurte, 1193) est
situé à 39 kilomètres Ouest de Laon et à
12 kilomètres Nord de Coucy.
Église paroissiale sous le vocable de saint Martin.
École primaire de garçons, école primaire de
filles confiée aux Soeurs de la Sainte-Famille d'Amiens. Bureau
de poste de Chauny ; perception de Saint-Paul-aux-Bois. Surface territoriale
: 776 hectares. Revenu annuel : 9,604, fr. Population : 1,114 habitants.
Malgré l'industrie sucrière, qui presque
partout a fait remplacer le chanvre par la betterave, on n'a pas
renoncé encore à cette ancienne culture pour laquelle le
sol de Bichancourt semble avoir une propriété particulière.
Les vastes prairies que les inondations de l'Oise viennent
engraisser chaque année donnent un foin très-recherché
; aussi les cultivateurs estiment-ils autant leurs prés, que leurs
terres à froment.
Bichancourt a trois hameaux : le Bac-Arblincourt, Bazin
et Marizelle.
Les lieux-dits les plus remarquables sont : le Liégemont,
le Roselet, le Champ-Saint-Martin, le Pré-Hâton, le
Chemin-Vert, la Jonquière, le Bois-l'Abbé, le Jardin-Pacquette,
la Fontaine-du-Maupas, le Jardin-Blanchette, la Ruelle-Culinette, la
Maladrerie, etc.
HISTORIQUE(1)1
La commune de Bichancourt était la dernière
de l'ancien évêché de Laon ; elle bordait au
Nord l'ancien diocèse de Noyon, dont Chauny faisait partie,
et à l'Ouest les anciennes limites du diocèse de Soissons,
auquel appartenaient Saint-Paul-aux-Bois et Manicamp. On voit encore,
dans la prairie de Marizelle, sur la rive gauche de l'Oise, au point
de jonction des trois diocèses, une borne qui a conservé
le nom de Borne des trois évêchés.
Une charte d'Élinand, évêque de Laon,
donne en 1089, le revenu de la cure de Bichancourt, ainsi que les
autels de Pierremande , de Champs et de Folembray à l'abbaye de
Nogent.
« Nous, Élinand, par la grâce de Dieu,
évêque de Laon, à tous présents et futurs,
faisons savoir que nous avons donné au monastère de Saint-Marie,
situé à Nogent, les quatre églises de Pierremande,
de Champs, de Bichancourt, de Folembray, pour aider au salut de notre
âme, et que nous avons enlevé ces églises des mains
des laïques, pour les concéder à perpétuité
à nos frères, qui dans ce monastère combattent pour
le Seigneur.
» Donné à Laon, l'an du Seigneur 1089
» (1)2 .

Ferme de Nogent appartenant à M. Cugnet, en
1910 (Coll. Cugnet)
La belle église de Bichancourt fut construite vers l'an 1550, probablement aux frais du monastère Sainte-Marie-de-Nogent, gros décimateur. Descarsin (Daniel) et Guilbert (Nicolas), dont on lit les noms à la clef de voûte de la nef, étaient alors marguilliers. La voûte du chœur fut reconstruite ou seulement terminée en 1586, date également gravée à la clef de voûte, et qui se retrouve très-exactement dans les comptes de fabrique que l'église de « monseigneur Sainct-Martin, de Bichancourt, » a le rare et précieux avantage de posséder. Ces comptes datent de l'année 1570. Au milieu de beaucoup de détails dépourvus aujourd'hui de tout intérêt, nous retrouvons sur les mœurs, les coutumes et les institutions de ce pays, de précieuses indications qui rentrent dans le domaine de l'histoire.
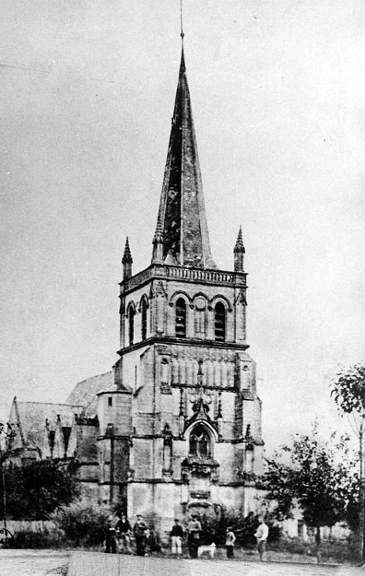
Eglise de Bichancourt avant 1917.
Ces comptes indiquent que Bichancourt avait aussi une Maladrerie : «
Reçu de Follet Noël, ung setier de terre, séant à
la Maladrerie de Bichancourt..... 1583. »
Cette terre qui porte encore ce nom, se trouve près
du lieu dit Saint-Ladre, dépendant aujourd'hui de la commune
de Sinceny.
En 1569 la fabrique achète trois cloches et paie
:
« A Jérôme... cordier à Chauny, pour avoir fait trois cordes servant aux cloches, X s.
» A Jehan Estrelin et Christophe Brochard, pour avoir fait des fléaux aux cloches, XXV s.
» A Pierre ... serrurier demeurant à Chaulny, pour avoir faict six razoires et trois flottes et trois verges servant aux cloches, X s. VI d.
» A Luc Féré, pour ungne pièche de boys qu'il a bailli pour faire des fléaux aux cloches, III s.»
Trente ans plus tard, Lédin, de Marle refond les cloches et en ajoute un quatrième. C'est en cette même année 1599, qu'on dote l'église d'une « chaire de vérité ». Nous ne pouvons résister au désir de transcrire les détails de cette construction :
« Payez pour un boisseau de chaulz pour faire la chaire de vérité, XVIII d.
» Pour des clous pour faire la chaire de vérité, IX s. VI d.
» Payez à Martin Périn, pour deulx planches de huict pieds, pour faire la dicte chaire, VI s. XIII d.
» A Gabriel Guilbert, pour avoir achevé la chaire de vérité, VI s. »
Cette chaire de vérité, qui subsista pendant
cent soixante et un ans, fut remplacée par une autre qui dut,
auprès de la première, paraître vraiment luxueuse
et monumentale.
« Payé à Jacques Lubin, menuisier, demeurant à Chauny, pour avoir fait le dossier de la chaire et l'impérial, avoir livré le Saint-Esprit et les fleurs de lys de la dite chaire, 44 livres. »
Les marguilliers de Bichancourt étaient généreux : chaque état de marché est toujours accompagné d'une certaine somme destinée à l'achat de quelques potz de vin, ce qui valut à ces messieurs en 1610, l'annotation suivante de l'archidiacre de Laon, en tournée :
« Défenses sont faites, pour l'advenir de plus payer aucuns vins lorsque l'on fera quelques marchés, pour l'église, sous peine de radiations des articles. »
Les marguilliers sont dociles à cette injonction, et l'année suivante nous les voyons, non plus donner du vin, mais payer à Pierre Lelong quinze sols de poissons, lors de la construction de la chapelle Notre-Dame ; un peu plus tard, ils donneront de la bière.
Le 17 août 1701, un violent orage, qui dura de dix
heures du soir à six heures du matin, faillit détruire
l'église toute entière : la foudre, fort heureusement,
n'atteignit que le clocher ; mais les cloches, entraînées
par la ruine et la chute de la charpente et du beffroi, furent brisées
ou du moins mises hors de service, ce qui nécessita une nouvelle
refonte.
Le clocher fut reconstruit ; les égalitaires de
93 devaient l'abattre après avoir enlevé deux de ses
cloches ; celle qu'ils laissèrent portait la légende
suivante :
« L'an 1701, j'ai été bénite par messire Quentin Sauvaige, curé de Bichancourt, et nommée Marie Louise, par haut et puissant seigneur de Harcourt,comte de Beuvron, et haute et puissante demoiselle Mademoiselle Louise de Harcourt, filz et fille de très haut et très puissant seigneur, messire Henri, duc de Harcourt, lieutenant général des camps et armées du roi, et dans sa province de Normandie, gouverneur de Tournay, et son ambassadeur extraordinaire en Espagne, et de très haute et très puissante dame Marie-Anne-Claudine Bruslart de Genlis, son épouse, leurs père et mère, seigneur et Dame de ce lieu. »
Il ne sera pas sans intérêt de placer ici un tableau comparatif des revenus de l'église de Bichancourt aux deux derniers siècles. Le produit s'élevait :
En 1575 à la somme de 39 l. 5 s.
« 1595 id de 60 l. 15 s. »
« 1625 id de 112 l. 7 s »
« 1668 id de 119 l 2 s. »
« 1702 id de 191 l. »
« 1750 id de 234 l. 10 s. »
« 1780 id de 311 l. 5 s. »
« 1790 id de 379 l. 10 s. »
La foi et la piété des fidèles savaient pourvoir à tous le besoins du culte, à tous les détails du service divin ! L'église de Bichancourt avait la Maison des complies, dont le revenu servait à payer celui qui était chargé de sonner Complies (l'Angélus) ; ce devoir ayant été négligé en l'année 1668, on signifia à Claude Gouvion et à Antoine Brochard, « que faute de sonner Complies, on les allait contraindre par justice. »
L'église possédait également la
Terre de la Passion, donné par Pierre Vaillant, avec
charge de faire prêcher la Passion tous les ans, le jour des Rameaux,
et chanter un Libera pour le repos de son âme. Vers 1580,
le prédicateur recevait douze deniers pour ses honoraires ; ils
furent portés à quatre sols en 1624.
Une rente spéciale était également
attachée à l'entretien des cloches et à l'huile,
pour la lampe du sanctuaire.
Les comptes de la fabrique nous font connaître
également une coutume particulière qui fut en usage
dans l'église de Bichancourt, jusque vers l'année 1635
: celle de présenter du vin aux fidèles après
la communion, ainsi qu'un petit pain ou corneau. Les jours de communion
étaient surtout la « Toussaint, Noël, Pasque Florye,
Jeudy Absolutz (Jeudi-Saint), Grand Pasque,Pasque Close, quelquefois
la Fête de Dieu et l'Assomption Nostre Dame. »
L'usage des corneaux et du vin, reste des agapes de la
primitive Église, était-il général à
cette époque ? Il serait difficile de résoudre cette
question ; peut-être Bichancourt avait-il emprunté cette
coutume au diocèse de Noyon dont il était voisin ; peut-être
le diocèse de Noyon l'avait-il emprunté lui-même
au diocèse de Beauvais, où cet usage paraît s'être
conservé jusqu'à la fin du XVIIe siècle
(1)6 .
Dans tous les cas, cette ancienne coutume est éminemment
respectable et nous paraît être une touchante application
de cette parole de Notre-Seigneur à ses disciples : Je ne veux
pas les renvoyer à jeûn, de crainte qu'ils ne tombent en
défaillance, pendant le chemin (2)7.
Depuis plusieurs années, des travaux sérieux
et bien exécutés ont été faits dans la
commune de Bichancourt, sur laquelle le vieux dicton, ils sont en
retard d'un siècle, tombe maintenant bien à faux.
Les chemins sont devenus praticables ; de jolies habitations embellissent
la plupart des rues ; une école de filles vient d'être
construite ; le clocher abattu par la révolution du siècle
dernier, s'est relevé plus coquet et plus élancé que
jamais : hâtons-nous d'ajouter que c'est aux dames de Bichancourt
qu'il doit en partie sa reconstruction.
Nos lecteurs nous sauront gré de rapporter ici
les circonstances qui ont amené cette reconstruction et que
nous nous reprocherions de passer sous silence :
En 1862, le vénérable et regretté
M. Parmentier, curé de Bichancourt, monte en chaire, le jour
des Rameaux, et, après avoir fait un court exposé des
travaux d'embellissement, faits à l'église depuis plusieurs
mois : « Mais cette belle église, ajoute-t-il, on ne
la voit pas ; on passe tout près d'elle, sur les routes, sur
les chemins de fer ; rien ne l'indique aux voyageurs. Il lui manque
un ornement -- et quel est cet ornement ?..... » A ces mots, des
voix se font entendre de toutes les parties de la nef : Un cloqué
! un cloqué ! nous voulons un cloqué !!! Le curé laisse
dire, puis reprenant : « Vous l'avez entendu, Messieurs les membres
du Conseil municipal ? un clocher ! voilà ce que toutes les femmes
vous demandent et voilà ce que votre pasteur désire. »
Le jour même, le conseil municipal se réunissait
et votait à l'unanimité 15,000 francs pour la reconstruction
du clocher.
Le jour de l'Ascension suivant, le curé adressait
en chaire quelques mots de félicitations sur la construction
du clocher, qui allait gracieusement couronner cette belle église
et faire l'illustration de la commune : « Mais, ajouta-t-il, ce
clocher sera-t-il un monument muet au milieu de la paroisse ? »
Les femmes, se rappelant leur premier succès,
s'écrièrent de nouveau : « Des cloques ! des
cloques ! nous voulons des cloques ! »
M. le curé annonça aussitôt une souscription
qui fut ouverte le jour même, et quelques semaines après,
on bénissait trois nouvelles cloches? Cette nouvelle dépense
montait à 9,845 francs.
Honneur aux dames de Bichancourt !
Marizelle est le hameau le plus important de la commune
de Bichancourt. Il est situé sur la route de Chauny à
Blérancourt, dont il occupe une étendue de plus de 2 kilomètres.
C'est surtout depuis 1825, époque où l'administration
de Saint-Gobain est venu établir à Chauny le Poli des
glaces et la Soudière, que Marizelle a pris de l'accroissement.
Avant la révolution de 1789, ce hameau ne présentait
qu'une rangée d'habitations, sur la rive droite de la route,
la rive gauche était propriété communale. Des
habitants, profitant des troubles qu'occasionnait la tourmente révolutionnaire,
trouvèrent économique de s'y choisir un emplacement
pour bâtir, et bientôt ces terrains, concédés
à de pareilles conditions, trouvèrent de nombreux amateurs.
Plus tard, cependant, l'administration municipale imposa un modique surcens
annuel, proportionné à la quantité de terrain,
à tous ceux qui s'en étaient emparés ; et, en 1830,
les envahisseurs du bien communal furent taxés pour une somme,
qui fut considérée comme prix d'acquisition.
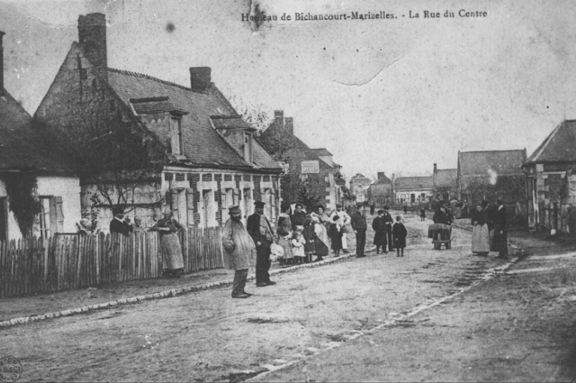
Vue de Marizelle avant 1917, vers l'Aventure. (Coll.
Casazza.)
Pendant de longues années, Marizelle fut impraticable
en hiver ; un terrain marécageux,un sol plat qui ne pouvait
favoriser l'écoulement des eaux, et par dessus tout, le voisinage
dangereux de la rivière d'Oise, contribuèrent à
le rendre inabordable pendant la mauvaise saison ; mais Marizelle a
eu sa large part dans le progrès dont nos moindres communes
ont bénéficié depuis trente ans ; une belle route
départementale le traverse dans toute sa longueur et lui a donné
un nouvel aspect.
Ajoutons à l'avantage de cette route, l'aisance
répandue à Marizelle par l'administration de Chauny,
aisance qui permet aux habitants de remplacer les chaumières
construites en terre, par des constructions plus élégantes
et plus saines qui, chaque jour, viennent embellir ce hameau privilégié.
.
Le nom de ce hameau vient du mode de passage avant l'établissement
d'un pont sur la rivière. Son site est agréable ;
longeant la colline qui forme la rive droite de l'Ailette, il domine
la rivière et la prairie. De la rive, la vue se promène
agréablement sur la plaine qui s'étend jusqu'à
Saint-aux-Bois, et sur les bois qui la limitent à droite et
à gauche.
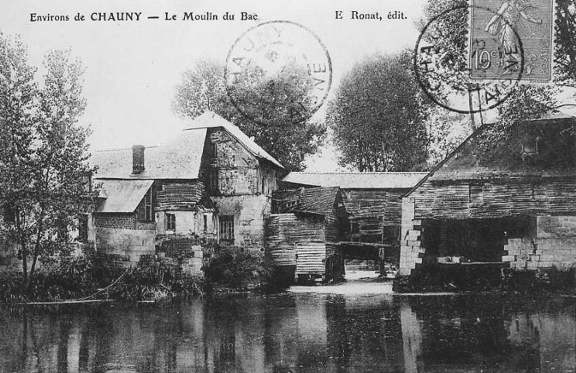
Le moulin du Bac, avant sa destruction en 1917.
Il existait autrefois une maison seigneuriale appelée
château d'Arblincourt ; de là le nom de Bac-Arblincourt,
donné à ce hameau.
La seigneurie d'Arblincourt, écrit M. Marville,
était, en 1533, un fief de François Ier.
Nous voyons que, le 8 mai, Jehan de Hangest, évêque de
Noyon, fit aveu de foi et hommage au roi, pour ses fiefs, terres et
seigneuries de Genlis, Abbécourt, Bichancourt et Arblincourt.
.
1102 Herselin d'Erblincourt.
1133 Guy, d'Erblincourt.
1150 Adam, d'Erblincourt.
1163 Guy I, d'Erblincourt.
1190 Adam et Raoul, d'Erblincourt.
1199 Robert, d'Erblincourt.
1210 Guy III, d'Erblincourt, frère du précédent.
1235 Jean d'Erblincourt, fils du précédent.
1265 Jeanne, d'Erblincourt.
1302 Yvetot, sgr. de Marizelle et d'Erblincourt.
1303 Jean, sgr. desdits.
1579 Pierre Brulart, sgr. de Genlis, du Bac-Arblincourt et de Bichancourt, par acquisition.
1608 Gilles Brulart, fils du précédent.
1645 Florimont Brulart, fils du précédent.
1663 Claude Brulart.
1686 Pierre Brulart.
1706 Gaspart Fayard de Sinceny, par acquisition.
Le cartulaire de Saint-Éloi-Fontaine et les comptes de fabrique de Bichancourt, nous ont donné tous ces noms.
1571 Jehan Testard.
1609 Anthoine Leclerq.
1637 Gaudefroy.
1639 Antoine Gatté.
1667 Boulanger.
1701 Quentin Sauvaige.
1705 Potier.
1714 Brion.
1745 Gautier.
1784 Nacqueret.
1802 J.-B. Demangeot, ancien prémontré de Genlis.
1803 Haury.
1804 Nacqueret.
1811 Louis Deullin, curé de Sinceny, desservant Bichancourt.
1824 François Bonjean, doyen de Chauny.
1827 E. Tévenart.
1837 P. Bertaux.
1839 Philippoteaux.
1852 T. Molin.
1861 A. Parmentier, décédé à Bichancourt.
1873 L. Parant.
1802 Descarsins.
1820 Parcheminier.
1836 Leroy.
1849 Montier.
1850 Baudoux.
1856 Leroy.
1863 Gadiffert.
1868 Benoit.
Charte
d'Elinand,
évêque de Laon, qui donne a l'abbaye de
Nogent,
les Autels de Pierremande, Champs, Bichancourt et Folembray,
1089.
Si præcedentim patrum vestigia velimus diligenter
attendere, et eorum exemplo studia nostra moresque propensius informare,
quanta in eis erga divinam culturam fuerit liberalitas, quantaque
devotio liquido colligimus quibus hoc propositum erat, quæ munus
suppetebant ecclesiis conferre, nec solum pastorali vigilantia præsse,
verum etiam pia sollicitudine, per omnia prodesse. Ego, igitur Elinandus,
Laudunensis Dei gratia præsul, notum esse volumus præsentibus
et futuris, qualiter ecclesiæ Sanctæ Mariæ quæ
sub monastica religione, apud Noviandum sita est, quatuor altaria de
Petramanda videlicet et Chaum et Becencurte et Folembraio pro salute
et animæ nostræ commemoratione contulimus, et abstracta de manu
laicorum fratribus ibidem domino militantibus perpetuo tenenda concessimus.
Ut igitur firmius vigeret hujusmodi efficentia, hoc scriptum fieri decrevimus
quod etiam in Synodali conventu assignatum et corroboratum reddidimus.
Et ne quis in posterum aliquatenus pervertere præsumat, anathematis
sententia objecimus.
Actum Lauduni, anno Domini 1089.
(Chron. de Nogent p. 419.)
TRADUCTION
DE LA CHARTE D'ELINAND,EVEQUE DE LAON :
« Si nous voulons considérer avec attention
l'empreinte laissée par les pères qui nous ont précédés
et nous conformer davantage dans nos moeurs et nos goûts à
leur exemple, nous proclamons clairement quelles furent, à l'égard
du culte divin, la générosité et la dévotion
de ces gens à qui cette fonction avait été proposée
et qui se chargeaient de servir les églises et d'être
utiles non seulement par leur vigilance pastorale mais encore par leur
pieuse sollicitude en toutes choses.
Aussi, nous, Elinand, évêque de Laon par
la grâce de Dieu, nous voulons qu'il soit notifié à
ceux qui sont présents et à nos descendants que nous
avons accordé les quatre autels de Pierremande, Champs, Bichancourt
et Folembray à l'église Sainte-Marie, sise à Nogent,
pour le salut et la mémoire de notre âme et que nous
les avons soustraits de la main des laïcs pour les donner à
garder à jamais aux frères qui y servent le seigneur.
Par conséquent, pour que l'efficacité de
cette mesure soit plus fermement établie,nous avons décidé
que soit écrit ce que nous avons attribué et fortifié
en assemblée synodale.
Pour que personne, à l'avenir, ne prétende
y porter atteinte en quoi que ce soit,nous nous y sommes opposés
par une formule d'excommunication.
Fait à Laon, en l'an 1089 de Notre Seigneur.»
.
Bulle du pape Eugène III
confirmant tous les biens
et priviléges de l'Abbaye de Nogent,
1145.
Datum Romæ, Incarnationis dominicæ, anno 1145.
(Ex. Chron. Nog. fol. 426-431.)
(Page 398)
Transaction entre l'Abbé de Nogent
et celui
de Saint-Eloi-Fontaine au sujet de Bichancourt,
1349
Jehan par la permission de Dieu, humble abbé de Notre-Dame de Nogent dessous Couchi, de l'ordre de Saint-Benoit, de la Diocèse de Laon, Et Hues humble abbé de l'Eglise de St.-Eloi fontaine de la Diocèse de Noyon firent accord au sujet des dîmes de la mense de Bisencourt. Les religieux de St.-Eloi fontaine paieront tous les ans à la fête de la Nativité de St-Jean-Baptiste aux religieux de Nongent, un sols et six deniers parisis pour les choses de la mance de Bissencourt sans préjudice à l'égard des autres propriétés qu'ils possèdent en la dite ville de Bissencourt, 15 Juin 1349.
1 (1) Nous avons emprunté un grand nombre de nos documents à des notes manuscrites, rédigées par feu M. Parmentier, curé de Bichancourt. Ces notes ont été données par l'auteur à M. l'abbé Caron, curé d'Autreville, qui a bien voulu les mettre à notre disposition. Nous sommes heureux d'exprimer publiquement notre reconnaissance à M. le curé d'Autreville, et pour les notes qu'il nous communiquées, et pour les soins si pénibles qu'il a donnés, en notre absence, à la correction de nos épreuves.
2 (1) Voir pièces justificatives n° II.
3 (2) Voir pièces justificatives n° IV.
4 (3) Voir pièces justificatives n° VI.
6 (1) L'abbé Delettre, dans son histoire du diocèse de Beauvais, dit que l'évêque Philippe de Dreux, mort en 1217, légua au chapitre de Gerbroy, une somme pour cette dépense.